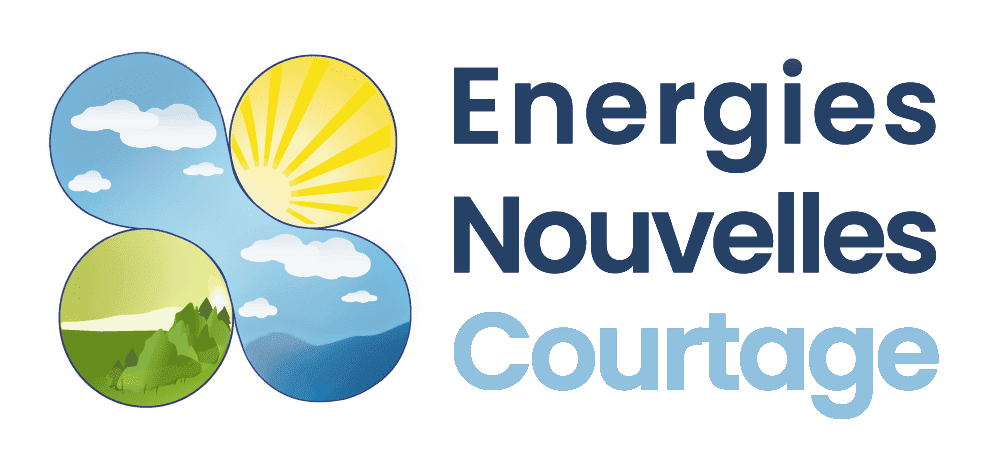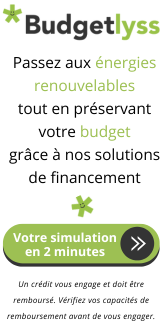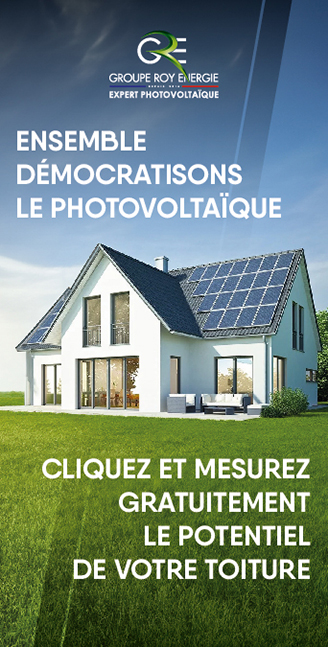Revolt.eco est une plateforme digitale tout-en-un qui simplifie et optimise chaque étape des projets solaires des installateurs photovoltaïques, grâce à des outils innovants comme le dimensionnement 3D, la gestion administrative automatisée et la création de devis personnalisés. Les utilisateurs constatent un gain de temps significatif et une augmentation de leurs ventes pouvant dépasser 30%.
Mis à jour le 18 mars 2025
Face à la montée des prix de l’électricité et à l’urgence de la transition énergétique, de plus en plus de citoyens, collectivités et entreprises cherchent des solutions pour produire et consommer leur propre énergie. L’autoconsommation collective s’inscrit pleinement dans cette dynamique : elle permet à plusieurs utilisateurs de partager localement une production d’électricité renouvelable, souvent issue de panneaux solaires. Mais pour fonctionner efficacement, ce modèle innovant repose sur un cadre réglementaire spécifique, récemment renforcé pour encourager son développement et améliorer sa rentabilité. Tour d’horizon des règles en vigueur et des évolutions majeures qui redessinent le paysage de l’énergie partagée en France.
Suppression de la taxe sur l’électricité partagée : quel impact pour les projets collectifs ?
Grâce à une avancée législative majeure, l’autoconsommation collective (ACC) franchit un cap décisif en France. Depuis le 6 février 2025, l’adoption de l’article 21 du Projet de loi de finances – entérinée via le recours au 49.3 – aligne désormais le régime fiscal de l’ACC sur celui de l’autoconsommation individuelle (ACI) pour les installations inférieures à 1 MW. Cette décision répond aux attentes de longue date d’acteurs du secteur comme Enerplan et La Plateforme Verte.
Concrètement, cette réforme entraîne la suppression de l’accise, une taxe de 3,37 centimes d’euro par kilowattheure qui pénalisait jusqu’alors les projets collectifs. Résultat : le coût de revient de l’électricité produite localement chute, offrant ainsi aux participants des tarifs environ 25 % plus bas. Cette suppression fiscale devient donc un véritable levier de rentabilité, rendant les projets d’autoconsommation locale nettement plus compétitifs face aux tarifs conventionnels du réseau.
Recevez 3 devis gratuits pour votre projet d’autoconsommation
LE RÔLE CLÉ DE LA PERSONNE MORALE ORGANISATRICE (PMO)
UNE ENTITEE CENTRALE, AUX MISSIONS MULTIPLES
Au cœur de toute opération d’autoconsommation collective, la Personne Morale Organisatrice (PMO) constitue l’élément central qui structure et coordonne le projet. Elle agit comme l’interface entre les participants (producteurs et consommateurs) et le gestionnaire du réseau public de distribution (GRD), c’est-à-dire l’opérateur chargé d’acheminer l’électricité sur le réseau local. Enedis assure ce rôle sur 95 % du territoire français.

Légalement, la création d’une PMO est une obligation : selon l’article L315-2 du Code de l’énergie, tous les participants doivent être réunis au sein de cette entité, quelle que soit sa forme juridique. Il peut s’agir d’une association loi 1901, d’une coopérative, d’une société (SAS, SCIC, SEM), d’une copropriété, voire directement d’une collectivité territoriale ou d’un bailleur social dans certains cas spécifiques. Cette liberté de forme permet d’adapter la structure au profil des participants et aux objectifs du projet.
La PMO a pour mission de gérer les relations contractuelles et de superviser la répartition de l’énergie produite. Elle définit, en concertation avec les participants, les modalités de partage de l’électricité (appelées clés de répartition), qu’elle transmet ensuite au gestionnaire du réseau pour application. Elle est également chargée de déclarer le projet au GRD, de signer la convention d’autoconsommation collective, et d’assurer la collecte des données de production et de consommation, transmises mensuellement par Enedis.
Cette convention d’autoconsommation collective est un document contractuel obligatoire entre la PMO et le gestionnaire de réseau. Elle encadre notamment les modalités de répartition de l’énergie, liste les participants, et précise les engagements de chaque partie. Sa signature est une étape clé qui officialise l’opération et permet le démarrage effectif du partage d’énergie.
Recevez 3 devis gratuits pour votre projet d’autoconsommation
ENCADREMENT JURIDIQUE ET RESPONSABILITES
Parmi ses autres responsabilités figurent la gestion des entrées et sorties de participants, la signature des accords de participation et de transmission de données (conformément au RGPD), ainsi que la conservation de ces documents pour d’éventuels contrôles. En complément, la PMO peut aussi animer la communauté d’utilisateurs, gérer la facturation, ou encore utiliser des outils numériques pour optimiser le fonctionnement de l’opération.
À ce titre, la PMO a des obligations strictes en matière de confidentialité et de gestion des données personnelles. En cas de non-respect du RGPD, notamment si les accords de transmission de données ne sont pas signés ou conservés, le gestionnaire de réseau peut alerter la CNIL. La PMO peut alors être tenue légalement responsable et faire l’objet de sanctions. Des contrôles aléatoires sont réalisés pour vérifier la conformité des projets.
Enfin, l’ensemble du cadre réglementaire de l’autoconsommation collective repose sur plusieurs textes législatifs et réglementaires : la loi du 24 février 2017 relative à l’autoconsommation, le Code de l’énergie (articles L315-1 à L315-3), ainsi que les décrets d’application publiés depuis 2017. Ces textes définissent précisément les obligations des parties, les périmètres autorisés et les conditions de mise en œuvre des projets ACC.
QUI PEUT PARTICIPER À L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE ?
Les projets d’ACC sont ouverts à tous, sous réserve de respecter certaines conditions. Tous les participants doivent être localisés dans un périmètre défini par la loi : selon l’article L315-2 du Code de l’énergie, la distance maximale entre les sites de production et de consommation est fixée à 2 kilomètres. Toutefois, en milieu rural, ce seuil peut être élargi jusqu’à 20 kilomètres pour mieux s’adapter aux contraintes géographiques de ces zones.
Pour intégrer un projet, producteurs et consommateurs doivent appartenir au même périmètre, être réunis sous une PMO, et s’engager via un contrat commun qui détermine la répartition de l’énergie et la gestion des installations. Ce cadre vise à favoriser la proximité entre production et consommation, limitant ainsi les pertes liées au transport d’électricité et renforçant l’autonomie énergétique locale.
Recevez 3 devis gratuits pour votre projet d’autoconsommation